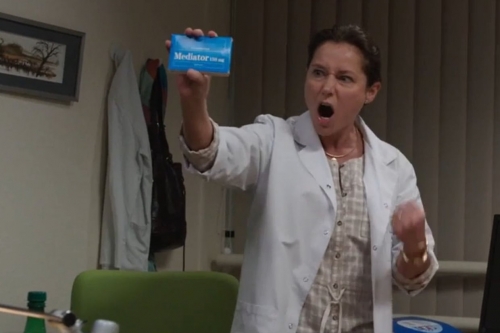De son tout premier, L’Assassin habite au 21 (1942), avec l’immense Pierre Fresnay, polar aussi limpide que lugubre, jusqu’au dernier, La Prisonnière (1968), chef d’œuvre érotique mais aussi charge contre le monde frelaté du « Pop Art », avec la superbe Elisabeth Wiener, Clouzot nous aura offert douze œuvres marquantes, qu’il est bien difficile d’inscrire dans une école particulière, sinon peut-être celle du pessimisme fantasmatique…
Il y a bien sûr chez Clouzot de la « direction de spectateurs » à foison, l’usage immodéré de l’astuce pour faire passer le trop-plein du scénario, de la tricherie visuelle allant de la complicité jusqu’à la sujétion. Sur ce point, Raymond Abellio, en particulier dans ses Fondements d’esthétique, aura été implacable, considérant Les Diaboliques (1955) comme une œuvre dont la fascination restait la seule ambition, celle-ci ne tenant que par quelques combines, qui une fois éventées, empêchaient toute vision ultérieure ; à l’inverse de l’œuvre d’art véritable, ouvrant à la contemplation sans fin. Et en effet, ce n’est pas dans les pièges d’une intrigue bien souvent retorse, qu’il faut chercher le talent de Clouzot. Il y a là, bien souvent, un traitement manipulateur du récit qui tend davantage à sidérer qu’à éveiller, une réduction de l’artiste au rôle de bateleur s’amusant de ses tours de passe-passe, un hommage aux puissances du faux qui peut paraître vain et finir par lasser. Mais Clouzot, bien heureusement, ce n’est pas que cela. Ce n’est pas dans le jeu rusé avec les ficelles du scénario que se niche le cinéaste qui nous importe, mais plutôt dans son aptitude à s’en extraire.
Son art se situe précisément dans cette capacité à tenir en haleine, à surprendre, à fasciner le spectateur qui accepte d’être malléable et donc à sa merci, mais sans pour autant lui refuser, s’il la souhaite, la liberté. Or celle-ci ne s’acquiert au cinéma qu’au prix d’une vision délivrée, autant que faire se peut, du vertige et du ravissement. Ainsi, Clouzot ne sacrifie-t-il jamais tout ce qui, à première vue, s’apparente à l’accessoire : traits de caractère secondaires, éléments anodins du décor, digressions dans la conduite du récit. Il ne néglige jamais par exemple, un regard qui change d’axe, un sourire mal réprimé, une main qui lentement se crispe, toutes ces variations infimes dans la gestuelle d’un personnage. Et c'est justement cela, cette culture du détail, qui préserve ces films de la routine des tromperies, du train-train des truquages, dans lesquels le cinéma moderne se complaît si volontiers. L’apparente vétille, cependant cruciale, qui dans la marge s’avère profondément révélatrice, et change ainsi, pour qui sait voir, le plaisant numéro d’adresse en bouleversant éclat d’authenticité. C’est peut-être cela la noblesse de l’art cinématographique, non pas renoncer au savoir-faire forain mais savoir ne pas s'y limiter ; le sertir de cette alliance si fragile entre vérité et beauté.
Dans sa critique parue à l’occasion de la sortie du Corbeau (1943), film vilipendé à l'époque aussi bien par la presse catholique que par les milieux communistes, Lucien Rebatet expliquait fort justement que le cinéaste était parvenu à « frôler le poncif mais en réussissant toujours à l’éviter d’un rapide et sûr coup de volant ». Si Clouzot a en effet réussi cette gageure, c’est au moins pour trois raisons. Parce qu’il a su laisser le champ libre à l’inventivité formelle sans que celle-ci n’exulte pour rien, notamment dans les jeux de de lumière de La Prisonnière ou de L’Enfer (1964), qui en renversant la logique narrative, témoignent si bien des affres de la séduction. Parce qu’il n’a jamais renoncé à saisir, dans la courte durée de ses plans, tout ce qui déroute et par là-même effraie, manière d’hommage rendu non plus aux énigmes contingentes mais bien au mystère de l’âme. Parce qu’il ne s’est pas contenté d’utiliser sans émotion des types et des figures, mais qu’il a osé leur manifester une attention extrême, nous permettant à sa suite d’être à la fois touché et meurtri par les échantillons d’humanité - buralistes et médecins, instituteurs et chanteuses-, qu’il observait avec autant d’effarement que de curiosité.
Nous recommandons tous ses films, même le boulevardier Miquette et sa mère (1950), ne serait-ce que pour la présence incomparable de Saturnin Fabre, mais s’il ne fallait en choisir qu’un, et en écartant compte-tenu de sa nature documentaire le passionnant Mystère Picasso (1956), ce serait Les Espions (1957), œuvre à la fois cocasse et inquiétante, qui pourrait être une sorte de trait d’union férocement drôle entre Lang et Franju, et qui n’a absolument aucun équivalent dans le cinéma français de l’époque.
(Texte paru dans Eléments n°168)