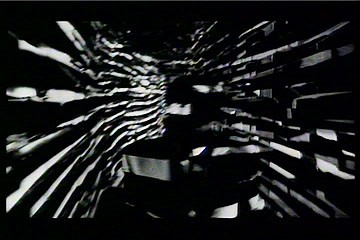Un cinéaste revient sur les lieux de tournage d’un film autrefois consacré au roman de Cervantès, et découvre que son ancien acteur, devenu fou, se prend désormais pour le Chevalier : L’Homme qui tua Don Quichotte a beau être une habile transposition, il ne fait que reprendre l’habituel propos de Terry Gilliam, arguant que les péripéties hautes en couleurs de la fantasmagorie permettent d’atténuer l’angoisse d’un réel aussi monocorde que coercitif. Ces lieux communs, que tout lycéen sait convoquer dès qu’il est question de confronter l’art et la vie, ont permis à ce cinéaste de produire au fil des années son lot d’images baroques. L’ensemble de sa filmographie toutefois, pèche par l’incapacité à s’extraire de l’illusion à gros traits, du plan-capharnaüm où tout est soigneusement en désordre, de l’opulence vaine du signifiant.
L’auteur des Aventures du Baron de Münchhausen (1989) ne s’interroge jamais vraiment sur la pluralité des relations tissées entre réel et imaginaire. Sous ses chausse-trappes et ses rebondissements, son cinéma est toujours bêtement dualiste, au sens où il ne parvient qu’à singer une possible porosité entre ces deux univers. Comme à l’accoutumée, il ne résiste pas à l’envie de manipuler son spectateur, d’abord en le soumettant à des visions semblant, contre toute logique, corroborer le délire du vieil homme (membres de l’Inquisition, chevaliers vindicatifs, princesses en tenue d’apparat), puis en le rassurant par de nombreux plans explicatifs (il ne s’agissait que de rêves, d’hallucinations, de canulars ou de bals costumés). Fléchage ostentatoire pour public infantilisé, qui ne cesse de signaler l’onirisme par les distorsions du cadre ou de rappeler le XXIè siècle à grands renforts d’inserts anachroniques. Cinéma retors, qui fait mine de jouer la possible invasion d’un monde par un autre, de ce qui est raisonné par ce qui est cru, alors que la ligne de partage reste inviolée.
Ce qui en fait d'ailleurs une lecture tout à fait secondaire du Quichotte, dont l‘intérêt réside avant tout dans le sens à apporter aux évidentes hallucinations de l’ingénieux hidalgo. C’est bien à travers les tribulations imaginaires de son héros, que Cervantès pointe les réalités de son époque. Ainsi la folie du personnage n’est-elle pas tant une échappatoire qu’un révélateur. Le monde qu’il traverse, vu à travers le prisme d’une éthique cruellement désuète, fait se confronter de manière explosive rectitude et revirements. L’auteur brave ainsi les nouvelles logiques de son temps, d’autant plus stupéfiantes qu’elles se révèlent implacables. Or que peut-on dire, à travers le personnage de Don Quichotte, de notre présent ? La plupart des adaptations contournent l’écueil en se bornant à illustrer les faits marquants du roman. S’en détache le Don Quichotte de G.W Pabst (1933), par l’intelligence de son découpage, l’élégance de ses intermèdes chantés, mais sans que la mise en abyme ne fonctionne. Une autre façon de traiter ce roman prodigieux est de ne s’attacher qu’à ses questions philosophiques. C’est ce que tente le minimaliste Honor de Cavalleria d’Albert Serra (2006), opposant à travers le corps et les paroles de ses deux personnages, l’idéal au pragmatisme, le désir à la nécessité.
Avant Gilliam, Orson Welles aura donc été le seul à se servir du Quichotte comme d’une machine à faire rendre gorge au réel. Même si son film n’a jamais été achevé, une partie en a été montée par Jess Franco en 1992. Dans l’Espagne de Cervantès, les moulins à vent installées depuis quelques années, représentent le progrès dans toute sa puissance irréductible, déformant les principes et les paysages traditionnels jusqu’à l’aberration ; c’est cela que Don Quichotte affronte. Sensible à cette beauté du combat perdu d’avance, au panache ornant le désespoir, Welles lui fait alors tenir tête, dans l’Espagne des années 60, à des mobylettes et des caméras. Gilliam quant à lui, ne dénonce pas la réalité mais l’une de ses recréations médiatiques : les aventures de ses deux héros sont prétextes à relayer la vulgate journalistique, riche de migrants inquiets, d’actrices harcelées, de terroristes fantasmés. Rien sur les vrais rapports de forces qui tiennent aujourd’hui les sociétés européennes.
Mais qu’est-ce qu’un homme en armure peut révéler du XXIè siècle ? Afin de garder une distance temporelle comparable à ce qui séparait le Siècle d’Or espagnol des temps chevaleresques, afin de pouvoir également jouer sur la différence des conceptions morales, peut-être faudrait-il plutôt suivre aujourd’hui un grognard de la Grande Armée, errant dans l’Union européenne, avec chevillée au coeur une fidélité hors du commun à l’empire napoléonien ? Il dévoilerait les reniements successifs d’une Europe toujours plus mondialisée, et de ce fait toujours plus impuissante … Mais quel cinéaste aurait envie de parler des valeurs du monde d’aujourd’hui ? Celles-ci en effet, tout en suscitant pour la forme quantité de moues de circonstances, ne souffrent plus discussion.
(Texte paru dans le n°173 de la revue Eléments)