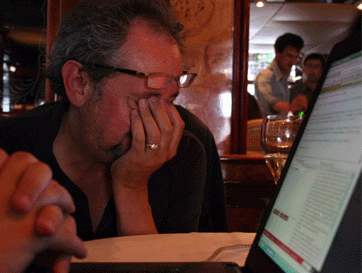Il y a peu, les quinze films que Robert Guédiguian a tourné depuis 1980 ont été réunis dans un coffret, et cette procédure inhabituelle du vivant d’un cinéaste s’explique sans doute par la grande cohérence d’une œuvre qui ne peut véritablement s’apprécier que dans sa totalité, tant chaque film tisse des liens thématiques ou stylistiques avec les autres, les radicalise ou les adoucit, en transpose les intrigues ou en décline les thèmes, utilisant qui plus la même troupe d’acteurs depuis presque trente ans, en particulier Ariane Ascaride, Pascale Roberts, Gérard Meylan, Jacques Boudet, Jean-Pierre Darroussin.
Cette cohérence est avant tout topographique et c’est justement une poétique, et une politique, du lieu qui apparaissent ici. A quelques exceptions près, la plupart de ces films sont en effet tournés à Marseille, plus précisément dans le quartier de l’Estaque, qui en est le théâtre des opérations. Mais au sein de cette enclave géographique, les récits de Guédiguian tournent toujours autour de lieux chargés de sens, tels la cimenterie désaffectée de Marius et Jeannette, la villa abandonnée de Ki lo sa, le garage en faillite d’A l’attaque, le cabaret déserté d’A la vie, à la mort etc… Métaphores du monde ouvrier, tout comme lui riches d’une culture et de codes en cours d’obsolescence, ces lieux chargés d’histoire(s) appartiennent au passé, et Guédiguian avec une sensibilité à fleur de peau et une précision d’entomologiste (qualités souvent contradictoires et de ce fait rarement associées chez un même cinéaste), en célèbre à la fois la disparition et la toujours possible renaissance ; tout comme celles d’aventures humaines étrangères à l’uniformisation, à l’insignifiance, à la dégradation de tous les sens aujourd’hui triomphantes. Ses films leur donnent une chance d’être à nouveau des « lieux de vie », c’est-à-dire des endroits où l’amour peut naître, la résistance s’organiser et ainsi une nouvelle histoire prendre racine, à l'opposé des sites artificiels où s'amassent les clones sans mémoire, réifiés et gentils.
Dans Marius et Jeannette, la jeune femme du titre ne comprend pas pourquoi on se permet de laisser à l’abandon la cimenterie où son père est mort, après y avoir longtemps travaillé, alors que dans le même temps on pense à inscrire la Cité des Papes d’Avignon à l’Unesco. C’est bien de cette naïveté constitutive que le cinéma de Guédiguian est pétri, dérisoirement au service de lieux à honorer car ayant su fonder les êtres qui les ont habités. Un lieu qui fonde l’humain, c’est peut-être cela qui se joue derrière le nom de ce café sans clients mais ripoliné appartenant au personnage joué par Meylan dans La ville est tranquille : « Bar Georges ». De même, qu’il s’agisse de l’immeuble de banlieue de L’argent fait le bonheur, des appartements entourant une courette de l’Estasque dans Marius et Jeannette, des différents quartiers marseillais du film choral La ville est tranquille, chaque personnage, dans ses errances, ses erreurs et sa capacité (ou non) à s’affranchir de toute une série d’oppressions, ne se définit que par l’endroit où il habite, c’est-à- dire d’où il regarde. Ainsi de film en film, une véritable réflexion sur le regard s’organise : celui que l’on porte sur d’autres lieux, autrement dit sur l’Autre ; celui que l’on oriente à partir de soi. En ce sens, la remarquable scène de la gare dans le dernier opus, Lady Jane, seul film de genre policier dans cette filmographie empreinte de réalisme poétique, permet à la fois de servir idéalement la tension d’une scène codifiée (l’attente par plusieurs personnages disséminés dans la gare d’un individu venant récupérer une rançon) mais également (car l’attente sera vaine), de dire la désorientation de notre temps, où les lieux se multiplient tout en s’uniformisant, où le regard se perd, ravi ou éteint par la multitude des formes qui l’entourent.
Dis-moi où tu habites, quels murs te protègent ou t’enserrent, quels lieux te hantent, je te dirai qui tu es, annonce effrontément, en plein règne panoptique, Robert Guédiguian, cinéaste que l’on pourrait qualifier de localiste, tant il ne fait apparaître ses figures et ses familles qu’en lien direct avec le paysage sur le fond duquel elles se détachent, justement parce qu’elles en sont nourries. L’aboutissement de cette réflexion sur le lieu (qui fonde plutôt qu'il n'emprisonne) et le regard (qui se dirige au lieu de se soumettre) est alors, logiquement, Le voyage en Arménie, admirable ode à l’identité défiant les caricatures identitaires.