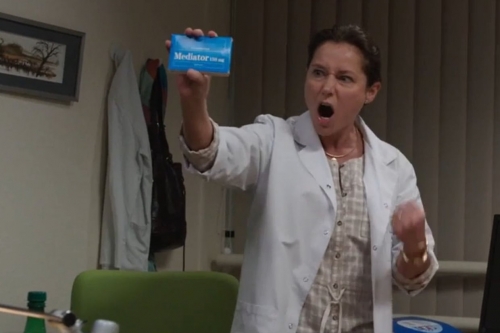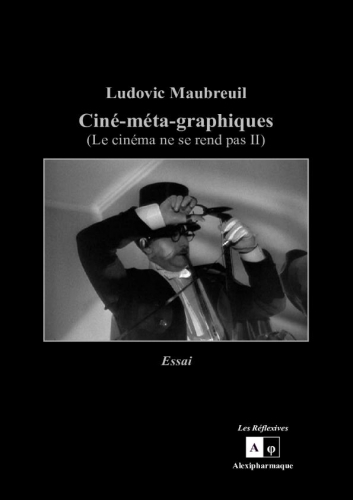Il y a 40 ans, le réalisateur d’origine autrichienne Fritz Lang (5 Décembre 1890 - 2 Aout 1976) nous quittait. Voici 40 raisons de continuer à s’intéresser à cet immense cinéaste :
Sa présence dans le « carré d’as » des mac-mahoniens, aux côtés de Walsh, Preminger et Losey.
Cette phrase de Godard : « tous les scénarios de Lang sont construits de la même façon : le hasard force un personnage à sortir de sa coquille d'individualiste et à devenir un héros tragique ».
Sa hantise du crime. A présent que n’importe qui peut soulager, au moindre prétexte, ses pulsions de mort, il n’est pas inutile de voir comment cette obsession du crime put être sublimée. Trente-huit films en témoignent.
Les ellipses audacieuses des films des années 20, qui annoncent Hitchcock.
Cette règle qui veut que la vengeance comme les pires remords soient inéluctables.
L’intensité trépidante des Araignées (1919), film d’aventures exotiques d’il y a presque 100 ans.
Théa Von Harbou, sa seconde femme (1922-1933). Romancière inspirée et personnage complexe, scénariste de ses plus beaux films allemands. Lorsqu’il retourne en Allemagne à la fin des années 50, tourner Le Tigre du Bengale (1958), c’est un roman de celle-ci qu’il adapte.
La magnificence des Nibelungen (1924). Qu’il s’agisse du cadre, des enchaînements ou des décors, c’est un chef d’œuvre dédié au « peuple allemand ».
De Kubrick à Blade Runner, en passant par la saga Star Wars, l’influence déterminante de Metropolis (1927).
L’impressionnante rigueur des scènes d’action, leur sécheresse même, qui confine à l’abstraction.
L’atmosphère trouble des Espions (1928), matrice européenne des meilleurs films noirs hollywoodiens.
L’essai que lui a consacré Michel Marmin (Pardès, 2004), riche de liens secrets avec Hergé, Balzac ou Max Stirner…
L’aisance narrative du très nationaliste Femme sur la Lune (1929), haletant récit d’anticipation.
L’inventivité sonore de ses deux premiers films parlants, M le maudit (1931) et Le Testament du Dr Mabuse (1933).
Antonin Artaud, en ange gardien, dans son seul film français, Liliom (1934).
La toute première apparition de l’adorable Gene Tierney, à vingt ans, dans Le retour de Franck James (1940).
Les liens subtils avec le cinéma de Renoir, qu’il exacerbe de pessimisme, avec ses remakes de La Chienne (La Rue Rouge, 1945) et de La Bête humaine (Désirs humains, 1954).
Joan Bennet, beauté glaçante avec laquelle il tourne quatre films. Frivole et cruelle, ou bien plutôt timide et indolente, à la fois victime et bourreau, elle personnifie idéalement la fatale ambivalence féminine.
La leçon de La Femme au portrait (1944) : avec Laura de Preminger, sans doute le plus sûr avertissement sur les dangers de la fascination esthétique.
Les ombres et lumières de Chasse à l’homme (1941), qui enserrent les protagonistes de manière implacable.
Cette sentence tirée de Cape et poignard (1946), « ce sont toujours les détails qui font la différence », résumant bien sa période américaine : malgré le terreau convenu des polars ou des westerns, une sensibilité particulière ne cesse de faire palpiter le cœur des images.
L’architecture rigoureuse des Bourreaux meurent aussi (1943), écrit avec Brecht.
La démonstration pré-houellebecquienne, avec La Rue Rouge notamment, que ceux qui détiennent le pouvoir symbolique, détiennent tout.
Cette phrase, qui illustre si bien la part mythique de son cinéma : « Le western n'est pas seulement l'histoire des États-Unis, mais ce qu'est la saga des Nibelungen pour les Européens ».
L’envoûtement du Secret derrière la porte (1948), l’une des plus belles métaphores sur ce que peut être une prison mentale.
La découverte que le vrai respect du public repose sur l’indifférence souveraine du cinéaste : celle de Lang, piquant le spectateur au vif, est bien gage d’éveil.
La splendeur expressionniste d’House by the river (1949).
M (1951) de Losey, remake passionnant et méconnu de M le maudit.
Le Mépris (1963) de Godard, à ne plus voir comme une fantaisie datée, mais bien comme une variation mélancolique de Désirs humains.
La noirceur violente de Règlements de compte (1953), son film préféré de la période américaine.
Cette conception germanique du destin, qui imprègne sans exception, chacun de ses films.
L’hommage romantique à Marlène Dietrich dans l’élégant western L’Ange des maudits (1951).
Le charme des Contrebandiers de Moonfleet (1955) : « ce film (qui) est aux œuvres capitales de Lang, ce que la huitième symphonie de Beethoven est à la septième et à la neuvième : un film tout en demi-teintes et en délicatesse, d’apparence plus légère, mais tout aussi pleinement réalisé et tout aussi profond » (Michel Marmin).
La critique aigue des mœurs de la presse, dans La Cinquième victime (1956).
L’impeccable Invraisemblable vérité (1956), dénonciation radicale des idéaux mortifères de la société américaine, qu’il devait juste après, quitter définitivement.
Sa présence hiératique et désenchantée, dans son propre rôle et après avoir arrêté le cinéma, dans Le Mépris.
L’érotisme agressif de la « danse du serpent » dans Le Tombeau Hindou (1959).
L’actualité de la série des Mabuse. Le quatrième volet (1960), qui est aussi son dernier film, annonce sans ambages le règne de la société panoptique.
Son absence d’héritier. Nul mieux que lui n’aura su annoncer la lâcheté et le suivisme des masses. Il manque d’autant plus aujourd’hui que ses prédictions les plus sombres se sont réalisées.
(Texte paru dans le numéro 162 de la revue Eléments)