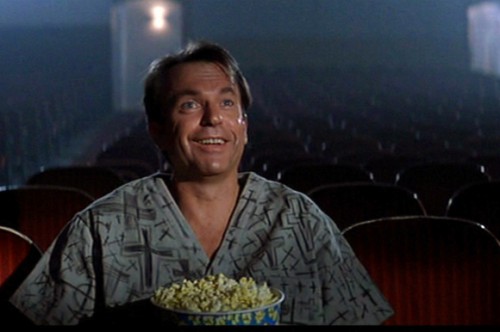Chères lectrices, chers lecteurs,
Après l'Erotisme, la Mort et le Cinéma lui-même, voici un tout nouveau questionnaire cinéphilique qui, je l'espère, saura remporter tous vos suffrages.
Comme à l'accoutumée, je le laisserai quelques jours sans mes propres réponses, pour éviter toute espèce d'influence, avant de publier mes vingt propositions.
Chacun est appelé à faire entendre sa voix.
Toutes seront légitimes.
Je m'engage à ce que chaque participation soit publiée sur Cinématique, et en toute transparence.
Je fais confiance à la cinéphilie de mon lectorat.
Même si l'on peut parfois se demander ce qu'il en reste, vive le Cinéma, et vive la France !
_____________________________________________________________________________________
Dans les commentaires, successivement, les réponses de :
Le prophète des huîtres
maryke
Ronan Ronin
Nathan
Damien (de sable)
Raphaël Nuage
Sur d'autres blogs :
Céline P., sur Le journal cinéma du Dr Orlof, là.
Vincent, sur Inisfree, ici et là.
Sylvain, sur Ma pause café, ici.
Fred MJG, sur Les nuits du chasseur de films, là, là aussi, là encore, là enfin.
Nolan et Antoine, sur De son coeur le vampire, ici.
Gérard Courant, sur Le journal cinéma du Dr Orlof, là.
Alain Paucard, sur Le Journal du Dr Orlof, ici.
Jérôme Leroy, sur Feu sur le quartier général, là.
Pascal Manuel Heu, sur Mister Arkadin, ici.
*
1) Quel film représente le mieux à vos yeux l'idéal démocratique ?
Tout l'irréalisme de cet idéal me paraît contenu dans Mr Smith au Sénat de Franck Capra, véritable brûlot contre tout ce qui se trame derrière le vocable étymologiquement mensonger de démocratie.
2) Au cinéma, pour quel Roi avez-vous un faible ?
Pour le Roi Arthur d'Excalibur (Nigel Terry), et la façon avec laquelle John Boorman le transfigure au cours du film, le faisant passer successivement par des états d'insouciance, d'effarement, de colère ou d'abandon, avant qu'il n'acquière une pleine conscience de son rôle.

3) Quelle est la plus belle émeute, révolte ou révolution jamais filmée ?
Celle de la Commune de Peter Watkins.
4) Si vous étiez ministre de la Culture, à quelle personnalité du cinéma remettriez-vous la Légion d'Honneur ?
Je commencerais par mettre un terme à cette mascarade.
5) Au cinéma, quel est votre Empereur préféré ?
Si Abel Gance avait pu tourner la suite de son Napoléon (qui se clôt lors de la campagne d'Italie, en 1797, donc avant le sacre), Albert Dieudonné aurait très certainement été un empereur mémorable, tant il est prodigieux en Général Bonaparte. Mais Gance ne put jamais tourner les six parties qu'il ambitionnait... Les autres Napoléon n'ayant pas une grande envergure, autant se tourner vers les empereurs romains : fourbe et pervers, le Caligula de La Tunique (Joy Robinson) est extraordinaire.
6) Si vous étiez Ministre de la Culture, quel serait votre premier mesure, premier acte symbolique ou premiers mots d'un discours, concernant le cinéma ?
Je reverrais les critères artistiques du CNC afin de comprendre pourquoi tant de films français ineptes sortent chaque semaine, alors même que des cinéastes de la trempe de Jean-Claude Brisseau, Joël Séria, Jean-Pierre Mocky ou Jean Marboeuf ont tant de difficultés à boucler leur budget.
7) Quel film vous semble, même involontairement, sur le fond ou sur la forme, d'inspiration fasciste ?
En dehors de sa période historique dûment authentifiée, le "fascisme" n'a jamais été autant mis à toutes les sauces qu'aujourd'hui, servant surtout à décridibiliser ceux qui ne jouent pas le jeu (pour mémoire, Starship Troopers de Verhoeven avait été à sa sortie qualifié de "film fasciste" !...). Si l'on se met d'accord sur quelques caractéristiques (la Force faisant loi, le groupe subjugué primant sur l'individu critique), on peut d'ailleurs trouver une coloration fasciste à de très nombreux films hollywoodiens, tous ceux notamment qui utilisent la Monoforme décrite par Peter Watkins, c'est-à-dire usant de diverses techniques de fascination afin de soumettre sans discussion. Autant donc revenir aux fondamentaux : le film le plus fasciste, et dans son propos et dans sa forme, est sans doute La Vieille Garde, d'Alessandro Blasetti (1934), décrivant une petite ville d'Italie juste avant la marche sur Rome.
8) Quel est le meilleur film sur la lutte des classes ?
Sans doute le chef-d'oeuvre de Denys de la Patellière, Rue des prairies, qui n'est qu'en apparence un mélodrame familial.
9) Au cinéma, qui a le mieux incarné la République ?
Ce n'est pas pour rouvrir les débats entre les partisans de Danton et ceux de Robespierre, mais il me semble bien que le Danton de Robert Enrico (Klaus-Maria Brandauer), dans son film-fleuve mais tenu de bout en bout, La Révolution française, a une incontestable prestance et une belle rigueur républicaine.
10) Quel film vous paraît le plus pertinent sur les coulisses du pouvoir dans le monde d'aujourd'hui?
La corruption et les compromissions du système politique ne sont plus, je crois, un secret pour personne. Dans sa veine comique (La gueule de l'autre de Pierre Tchernia) ou tragique (Mort d'un pourri de Georges Lautner), le cinéma français a su à une époque le montrer avec brio. Aujourd'hui cependant, le pouvoir semble davantage aux mains des financiers de toute obédience, et sur ce point Margin Call de JC Chandor est plutôt éloquent. Mais en amont de tout cela, ce qui gouverne vraiment les uns et les autres, ce qui fait et défait les empires, ne serait-ce pas plutôt l'immuable guerre des sexes ? Le film politique le plus pertinent de ces dernières années sur les processus de domination me semble alors bel et bien Choses secrètes de Jean-Claude Brisseau !
11) L'anarchisme au cinéma, c'est qui ou quoi ?
Pascal Thomas, pour la liberté qu'il prend avec ses sujets et son absence de révérence au cinématographiquement correct.
12) Quelle est la meilleure biographie filmée d'une femme ou d'un homme de pouvoir ?
Déjà cité, mais film (et cinéaste) exceptionnel : Hitler, un film d'Allemagne de Hans-Jürgen Syberberg.
13) De quelle femme ou quel homme de pouvoir, aimeriez-vous voir filmer la biographie ?
Jeanne d'Arc, Louis XI, Napoléon ou Staline attendent toujours un film à leur mesure.
14) Au cinéma, quel personnage de fiction évoque le style des politiciens français suivants : Nicolas Sarkozy, François Hollande, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ? (vous pouvez en choisir d'autres)
Sarkozy : Rusé, manipulateur et dénué de scrupules, le Nabot dans toutes les séries Il était une fois... d'Alain Barillé
Hollande : les différents rôles de Frank Morgan dans le Magicien d'Oz, ne pouvant empêcher tout un chacun de regarder derrière le rideau (où tout est faux).
Mélenchon : roulant des yeux, haussant le ton, prenant des poses, mais aussi inoffensif qu'un Ewok.
Marine Le Pen : telle la Méduse du Choc des Titans, tous la redoutent et la fuient mais tous finissent par converger vers son antre.


15) Quel film de propagande n'en est-il pas moins un grand film ?
Au début de la seconde Guerre mondiale, Michael Powell a tourné quelques films soutenant l'effort de guerre des Alliés. L'Espion Noir, avec le grand Conrad Veidt, est sans doute le moins manichéen et le plus émouvant d'entre eux.
16) Quel a été pour vous, en France, le meilleur Ministre de la Culture ? Expliquez pourquoi en deux mots.
Quelle idée !
17) Quel est le meilleur « film de procès »
Ma préférence va plutôt aux films qui, soudain, contiennent une séquence de procès venant de façon inattendue empiéter sur le récit, nous imposant son rythme et ses codes. Comme dans le très brillant Eureka de Nicolas Roeg.
18) Quel film vous paraît le plus lucide sur le quatrième pouvoir (les medias) ?
Sur la mesquinerie, la lâcheté et la cupidité des journalistes en général, Le Gouffre aux chimères de Billy Wilder est remarquable. Mais pour ce qui est des collusions de la "démocratie médiatico-parlementaire" (Kacem), je ne vois vraiment pas. Il serait peut-être temps qu'un film de fiction brode sur Les nouveaux chiens de garde d'Halimi.
19) Citez un film que vous aimez et qui vous semble assurément « de droite ».
Le problème, bien évidemment, c'est qu'il y a droite et droite. Conservateurs bougons et libéraux échevelés, défenseurs du monde d'avant et capitalistes sans mémoire... (quelques mots à ce propos, ici). Si l'on admet que la droite digne de ce nom est celle qui préfèrera toujours les communautés et leurs cadres traditionnels, aux déstructurations de la modernité et à l'hyperindividualisme qui en découle, alors Les Raisins de la colère de John Ford, implacable charge contre les ravages de l'idéologie de progrès, est sans doute l'un des plus beaux films de droite.
20) Citez un film que vous aimez et qui vous semble certainement « de gauche ».
Il y a également gauche et gauche. La libertaire étant le plus souvent celle qui sait le mieux faire le jeu des libéraux. Mais il y aussi une gauche qui n'a pas oublié... les oubliés du système. Certainement alors, la Commune de Peter Watkins, où les "acteurs" du film ont justement été choisis parmi ceux qui pourraient, aujourd'hui, se soulever, et qui fait sans cesse un va-et-vient troublant entre la fiction et la réalité, inventant ainsi une sorte de cinéma participatif, est un grand film de gauche.