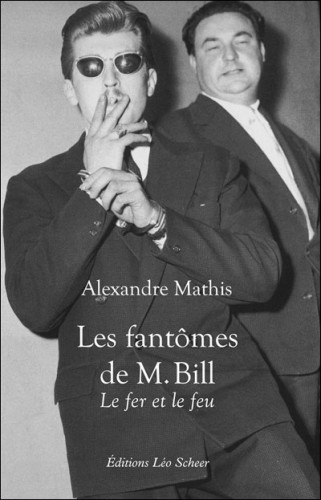Dans l’univers étriqué de la chanson française, qui sue sur les rimes et louche sur le voisin, Murat est une sorte de miracle, ce que vient une fois de plus confirmer le dernier album en date, “Grand lièvre”, dont le titre ne reprend pas pour rien le nom d’une espèce en voie de disparition. Avec ses textes exigeants, jamais tire-larmes mais à la nostalgie tenace, Murat c’est l’anti-Aznavour ; avec ses expressions désuètes et ses lapsus anglais, son érotisme païen et son besoin inassouvi de héros, l’improbable croisement entre Ferré et Dylan.
Si l’on rencontre, au fil de ses albums, « des citrons volages » et de « l’herbe têtue », « un voleur de rhubarbe » ou un « coeur hérissé de tessons », le chanteur n’en prend pas moins acte de ce qu’une partie du surréalisme a fait long feu, récupéré, et de quelle manière, par l’hydre publicitaire. Son écriture se veut dès lors plus ambitieuse qu’une simple mise en relation de mots rares, qu’une facile mise à l’honneur de rapports incongrus entre les choses, toujours bâties sur les correspondances visuelles et entraînant ainsi pour celui qui les reçoit, passivité et commode mise à distance.C'est cela la tyrannie des images : creuser une froide distance sous l'apparence de la plus conviviale proximité, puisqu'on finit toujours par négliger ce que l'on a reconnu sans effort. Ainsi, plutôt que d’accepter comme tant d’autres le règne de l’optique, qui ne nous permet plus d’appréhender le monde autrement que par son image infiniment diffractée, Murat en développe une vision pluri-sensorielle où l'on sent, touche et goûte ! En référence à l’haïku de Basho (« Le vieil étang/une grenouille saute dedans/le bruit de l’eau »), Kenneth White, dans Le Plateau de l’Albatros, se demandait pourquoi la plupart des haïku écrits par des Occidentaux sont si ternes, et faisait la réponse suivante : si les grenouilles sont abondantes (c’est-à-dire les images), il y manque le vieil étang, et par conséquent le bruit de l’eau : « il manque le fond, et la prise de contact de l’esprit avec ce fond ». Le bruit de l’eau, on peut le retrouver dans l’entreprise proprement géopoétique de Jean-Louis Murat, géopoétique au sens de son inventeur, Kenneth White, expliquant que ce qu’il nous faut aujourd’hui, « après la poétique des dieux et des mythes, de l’idéal et de la métaphysique, c’est une poétique de l’espace, de la terre, du monde ». Plutôt que se lamenter sur les refuges perdus, ou vanter les aventures prochaines, les chansons de Murat, et tout particulièrement celles de ce dernier album, témoignent de cet élan. Celui qui tente de vous conduire du lieu qui vous fonde à celui que l’on désire. Fidèle au premier mais consumé par le second, avec en retour la morsure, celle du temps et celle de l’Autre, la morsure qui entretient la douleur tout en ravivant le feu.
« Ce monde, dans lequel je subis ce que je subis, ce monde moderne, enfin, diable ! que voulez-vous que j’y fasse ? » s’exclamait André Breton, dans le premier Manifeste du Surréalisme. En écho, sept décennies plus tard, Jean-Louis Murat dans Le fier amant de la terre assure : « dans ce monde moderne, je ne suis pas chez moi ». Bien sûr aujourd’hui comme hier, défier de ce qui nous enserre fait partie du jeu, mais les mots de Murat, la poésie si forte de ces mots-là, rendent bien inutiles les discussions autour de son style dandy, ses embardées misanthropes ou son cynisme accusé. Murat, c’est un homme qui vit loin de la ville, dans l’ombre changeante et les jardins chaotiques, et qui a développé au fil de chansons plus troublantes les unes que les autres, un rapport à la terre qui passe avant tout par la glorification de ses rythmes, l’errance parmi ses formes, la mélancolie d’une énergie tantôt transmise et tantôt refusée. Jeu élégant avec les mots d’hier, ajout de rires d’enfants, d’expressions en patois ou de chœurs, errance au creux d’histoires d’amour ramifiées (histoires avec des femmes mais aussi avec ses anciennes chansons dont les échos surgissent comme un jeu) : nous sommes bien à l’opposé de l’atomisation libérale, qui voit tant de moi(s) se presser de jérémiades en gâteries, sans se soucier de leur communauté, avide de novlangue universelle sur boîtes à rythmes interchangeables.
Dans une chanson, il ne s’agit plus de juger ou de se plaindre, juste de se souvenir avant d’envisager ; simplement de se remémorer ce qu’on était, ce qu’on aimait, avant de se lancer à l’assaut d’une nouvelle âme, celle qu’on reforme à l’intérieur de soi après la peine, ou celle qu’on s’en va conquérir chez celle qui, sauf erreur, vous attend. Colliger les noms de villes et de rivières, de collines et de hameaux, d’Auvergne et d’ailleurs, qui dans les titres de ses chansons ou le secret de leurs couplets, composent ces « Terres de France » depuis trente ans, c’est les prendre alors pour ce qu’ils sont : les coutures précises d’un « ruban de mémoire qui se défait », quelque part entre Vaison-la-Romaine et Beaugency, Cabourg et Saint-Malo, Lyon et Genève, Tullière et Sanadoire, Pessade et Courbanges… Dans L’intermède romain, admirable nouvelle de Drieu, le narrateur qui se donnait le nom de « Cœur de lièvre » avouait enfin : « J’étais un lièvre tout seul dans un guéret, plein d’inquiétude vaine, défaillant de la volupté d’être inquiet pour rien (…) Je n’avais besoin que de cela, de cette seule joie, écouter le battement de mon cœur, cette confidence continue de la mort à la vie ». Il semble bien que ce soit cette confidence de la mort à la vie, source de joie grave, qui nous rend si précieux l’art de Jean-Louis Murat.
(Une version de ce texte est parue dans le n° 41 de la revue Causeur)